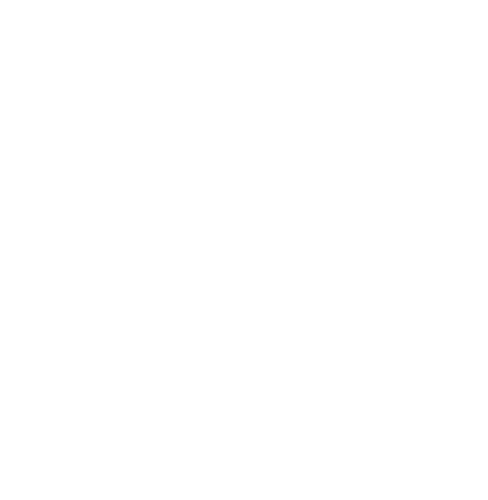Paul Cormier
Greffé du rein
Petite musique sur rythme de cœur battant
Récit sonore d’une chirurgie cardiaque dite « à cœur battant », utilisée notamment chez les greffés rénaux. La phrase « Docteur Dô, doué des doigts », fait référence au chirurgien qui a dirigé l’intervention.
Oeuvre sonore réalisée dans le cadre des ateliers de création donnés par Ana Tapia Rousiouk.
Conversation du rein
Sur la scène, deux espaces : côté jardin, un lit d’hôpital ; côté cour, un coin salon.
Personnages :
- Paul, greffé du rein, vêtu d’une jaquette d’hôpital, puis de vêtements civils ;
- Jacques, le rein greffé, homme vêtu d’une combinaison mouillée à son entrée ;
- Médecin, homme ou femme, sur scène ou en voix hors champ ;
- Infirmière, homme ou femme, sur scène ou en voix hors champ.
Scène dans la pénombre. Lumière sur l’espace hôpital.
Médecin. La greffe s’est vraiment bien déroulée. Le seul problème, c’est que le rein ne fonctionne pas bien : il ne filtre pas assez. Nous allons devoir faire de la dialyse. On va vous installer une fistule à la base du cou. Il y a aussi cette histoire de cœur, hier soir. Nous pensons que vous avez fait un petit infarctus. Nous devons faire une coronographie pour vérifier et tenter de débloquer les artères. Le problème, c’est que le colorant utilisé est potentiellement toxique pour votre rein.
Paul. D’après ce que je comprends, on n’a pas vraiment le choix.
Médecin. C’est vous qui décidez… (Il sort.)
Paul (grimaçant de douleur). On dirait que ça pousse dans la cicatrice, ouch ! Ben voyons ! Ayoye !
Infirmière. Oui, ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas, ça va bien aller !
Paul (en soupirant et en levant les yeux au ciel). Ça va bien aller, ça va bien aller, pu capable d’entendre ça, ça annonce toujours des mauvaises nouvelles ! (Il se touche le ventre et grimace.) Ouch ! Ben oui, ça va bien aller ! J’ai découvert cette arnaque, j’avais huit ans. Le médecin disait… Ouch ! Ben voyons !
Bruit de succion, suivi d’un éclat d’eau. Lumière sur le personnage.
Jacques (s’essuyant le visage). Bonjour, je suis ton nouveau rein. Enfin, pas si nouveau, j’étais à quelqu’un d’autre avant…
Paul (ébahi, se frottant les yeux). Maudit qu’ils m’en ont donné de la forte ! Ça n’a pas de bon sens ! Pour une hallucination, je te jure, t’as l’air vrai.
Jacques. Mais je te regarde là, ils m’ont mis dans ton ventre ?
Paul. Oui, pas besoin d’aller chercher les reins d’origine, on trouve une place dans le ventre, on fait les connexions.
Jacques. C’est drôle. Avant, j’entendais juste ce que les gens disaient dans notre dos. Là je vais peut-être en entendre des belles !
Paul (en aparté). Le monde me croira jamais : je discute de mon intimité avec mon REIN ! MON rein ? (Il se tourne vers Jacques.) Bon, écoute bien, mon rein, on jase là, mettons que tu sois vraiment mon rein, faudrait que je te parle. C’est parce que, bon, t’es bien accroché, c’est jute que tu travailles pas assez fort.
Jacques. Comment ça ?
Paul. Ben, tu es censé filtrer, mais il semble que c’est pas assez !
Jacques. Je fais ce que je peux !
Paul. Pourrais-tu essayer un peu plus fort ?
Jacques (s’emportant). Heille, ça va faire. Moi je suis là pour aider, gratis, pas pour me faire engueuler ! En plus de ça, imagine-toi donc que je l’ai pas eu trop facile. Je te parle même pas de la greffe, mais depuis que je loge chez toi : chaque session d’hémodialyse me brasse, tu croirais pas ça. Pis t’en rajoutes avec ton histoire de cœur. Il s’est excité l’autre jour, ça a fait tilter la machine. Tu savais que le colorant de la coronographie m’étouffait ?
Paul. Oui, ils m’ont dit ça.
Jacques. Ça fait que, tes commentaires, tu peux les garder pour toi.
Paul. OK, j’avoue, mais c’est pas toujours évident. On met beaucoup d’espoir dans la greffe, puis là on a peur d’avoir donné un coup dans le vide. Mais, excuse-moi d’avoir été un peu brusque.
Jacques. Un peu… OK. Je veux bien essayer de travailler plus fort, mais il faut que tu gardes ton calme.
Noir.
Médecin. Bon, le taux de créatinine semble stabilisé. Vous pouvez rentrer à la maison, mais minimisez les contacts, évitez les endroits très fréquentés, lavez-vous les mains… Bonne chance !
Paul enlève sa jaquette et marche vers le coin salon.
En hors champ, voix de François Legault : « Restez chez vous, ça va bien aller ! »
Éclairage sur le coin salon, où Paul se tient debout, regardant au loin.
Paul. Ça va ben aller, ça va ben aller. Ça annonce toujours une mauvaise nouvelle cette affaire-là. Parlant de mauvaise nouvelle, la créatinine a recommencé à monter. On parle de faire une biopsie. On fait toujours ça quelques mois après la greffe, mais là, la hausse soudaine du taux de créatinine n’est pas bon signe. (Il grimace de douleur en se tenant le ventre.) Ouch ! Je sens qu’on va avoir de la visite !
Jacques (souriant). Salut !
Sonnerie de téléphone.
Médecin (au téléphone). Bonjour, ici Docteur Laurin. La biopsie que vous avez passée révèle un « mini » rejet.
Jacques et Paul (en même temps, stupéfaits). QUOI ? Un rejet ?
Médecin. Ne vous inquiétez pas, après un traitement intensif, ça va bien aller !
Jacques et Paul, en même temps, roulent des yeux et soupirent.
Paul (accusateur). Un rejet, tu imagines ? Pourquoi tu me fais ça ?
Jacques (s’emportant, incisif). Moi ? Te faire « ça », à TOI ? Je te ferai remarquer que MOI, je n’ai rien demandé, je suis transplanté, gratis. Faque tu vas lâcher tes grands airs et revenir sur terre. Ça a l’air qu’on est pris avec ton système qui joue au yo-yo. C’est comme si t’étais en guerre contre moi ! Moi, je suis juste un petit rein de rien, qui veut bien faire sa job de rein, calice !
Paul. Pas obligé de sacrer, quand même !
Jacques. Je sacre pas, je me décris : cortex, médullaire, bassinet, calice.
Paul. Ah, je comprends. OK Jacques. Je vais faire attention. C’est vrai qu’on a plus de chances de réussite si on travaille ensemble.
Jacques (curieux, après un silence). Au fait, pourquoi tu m’as appelé Jacques ?
Paul. La partie la plus simple de la réponse : un soir, sur l’oreiller, pendant qu’une main caressait la cicatrice récemment libérée de ses agrafes, ton nom a surgi, comme ça, sans raison précise. Ça aurait pu être Albert, ou Nestor, ou Reynald (hum !). C’est tombé sur Jacques.
Jacques (moqueur). « Reynald », c’est insuffisant !
Paul. En effet ! Il fallait te donner un nom, à cause de l’importance de la transplantation, pour améliorer ma vie et allonger son espérance (et la tienne, par le fait même). Il fallait te nommer pour te souhaiter officiellement la bienvenue dans mon corps. (Il sourit.) Mais pas quelque chose d’incongru, comme Rex, ou Rein-tintin !
Jacques. Ha ! Très drôle. Mais tu m’aurais appelé Pierre, j’aurais pas été impressionné ! Les pierres, pour un rein, c’est pas trop bon ! Le nom que tu m’as donné n’est pas très original, mais ça m’importe peu, dans le fond. C’est la première fois qu’on m’appelle autrement que « rein droit ».
Paul. En plus de ça, après la greffe on se retrouve à penser au donneur, on pense à qui ça pourrait être, au genre de personne qu’il, ou elle, a pu être de son vivant. On se demande si quelque chose, une qualité, ou un défaut, de cette personne se transmet à nous.
Jacques. Moi, je suis lié par le secret professionnel !
Paul. Non mais, sérieux ! Une greffe, c’est plus qu’un simple transfert de tissu d’une personne à une autre. Une personne décide, librement, de donner. Donner, le mot le dit, c’est gratuit. Ça montre le bon côté des humains. Beaucoup de gens hésitent à donner un rein ou un autre organe après leur décès par crainte de ne pas être en un seul morceau à la résurrection des morts. Imagine, moi j’arriverai avec un morceau en surplus !
Jacques. Un corps IKEA.
Paul. Ouais, on peut dire. Mais la greffe est quelque chose d’important. Je le savais dans ma tête et dans mon corps, mais c’est dans le regard des autres que j’ai saisi l’envergue de ce que ça représente. J’ai déjà reçu des prothèses métalliques aux hanches et aux genoux. Les gens étaient admiratifs. À cette époque, il y avait une série, L’homme de six millions, dans laquelle un homme qui porte des prothèses bioniques développe toutes sortes de pouvoirs qui améliorent ses performances physiques. Alors les gens m’appelaient « l’homme bionique », surtout quand je déclenchais les systèmes d’alarme à l’aéroport ! Mais devant la greffe, ils montrent de la révérence, comme s’il y avait quelque chose qui dépasse la mécanique. Quelque chose de magique.
Jacques. Te sens-tu différent avec moi ?
Paul. Je ne me sens pas si différent, mais je sais que tu es là, en tout temps. Je porte en moi du vivant, autre que celui hérité de mes parents, et j’en suis redevable à un inconnu et sa famille. Et toi, tu l’as vécue comment, la greffe ?
Jacques (sérieux, puis dramatique). Ma vie d’avant était très ordinaire. Le battement régulier du sang rythmait la journée et mon travail de rein. (Il simule le battement d’un cœur en ouvrant et en fermant la main.) Pouiche-pouiche. Le grésillement diffus de l’activité électrique enrobait ma routine. Tout à coup, j’ai senti une vive contraction, puis plus rien. (Silence, quelques secondes.) Silence. Que l’écho de quelque gouttelette obéissant à la loi de la gravité. Je me suis cru dans un étau. J’étouffais. Tu connais l’expression « un silence de mort » ? (Silence.) Puis il y a eu comme une lumière autour de moi. Vertige. Je m’envole pour atterrir sur une masse froide, non, glacée. Je me recroqueville pour conserver ma chaleur. J’ai dû perdre connaissance. On s’active autour de moi, dans un cliquetis d’instruments. Le vertige me reprend. On me manipule, on me place, on me replace. Après encore d’autres picotements, je sens une chaleur s’infuser tout doucement en moi, un sang nouveau me baigner d’un goût différent, un nouveau pouiche-pouiche battre la mesure. Ton sang me réchauffe.
Paul (ému). Mon sang, wow, ça me touche beaucoup… (Un temps.) Il y a autre chose qu’il faut que je te dise. Tu te rappelles mes histoires de cœur ?
Jacques. Qu’est-ce que tu lui as fait, encore ?
Paul. Ben non, pas ce cœur-là. Je dois être opéré à cœur ouvert. C’est une chirurgie importante. Un des problèmes : tu peux en être sérieusement affecté.
Jacques. Affecté comment ?
Paul. Affecté entièrement et définitivement. La semaine dernière on a refait l’examen préopératoire : le vieux datait de plus de six mois alors, pandémie et délestage obligent, on devait le refaire. Le médecin que j’ai rencontré m’a dit des choses que je savais déjà : les risques de décès sont importants, les risques de perdre le rein très élevés.
Jacques (inquiet). Je vais mourir ?
Paul. Je ne sais pas. Mais il me les a dites, ces choses, de façon si sèche et définitive que je suis sorti de là complètement sonné. Je me suis calmé en me disant que j’avais le temps d’y penser, de consulter quelqu’un, si je me fie aux rumeurs de délestage. Puis, lundi, l’hôpital a appelé : ce sera vendredi, après-demain.
Jacques. Tu me niaises ?
Paul. Non, pas du tout. J’ai déjà dit oui à l’opération, mais je peux toujours virer de bord. Qu’est-ce qui est le mieux ? Vivre comme maintenant, surtout avec toi qui m’aides (clin d’œil), risquant à tout moment de tomber raide mort d’une crise cardiaque, ou bien passer au travers d’une autre chirurgie et prolonger peut-être ma vie, au risque de te perdre et retourner à la dialyse ?
Jacques (triste, essuyant une larme). Je commençais juste à m’attacher à toi, moi.
Paul. Écoute-moi. Si jamais on ne se revoit pas, je veux que tu saches que je t’apprécie vraiment. Et je te remercie pour tout. Mais moi, contre toute logique, j’ai l’espoir de te retrouver de l’autre côté de l’opération.
Jacques (reniflant). T’es bien mieux !
Paul. Adieu l’ami !
Rideau.
Ça va bien aller, de travers
Ne vous inquiétez pas, Madame. Ici, il va se faire des amis. Vous verrez, ça va bien aller.
6 juin 1960. J’ai huit ans. Je suis à l’Hôpital Maisonneuve, dans une salle d’examen aux murs couleur vomi séché. Je suis familier avec l’hôpital, y étant entré clandestinement à quelques reprises pour visiter mon père mourant. Les visites étaient interdites aux moins de douze ans.
Au fond de la pièce, ma mère discute avec le médecin. Je comprends que certains adultes croient que les enfants sont sourds, ou incapables d’intelligence. Je comprends qu’on me gardera à l’hôpital, en raison d’un mystérieux gonflement aux genoux qui m’affecte depuis quelques mois.
Ce qui me vient d’abord à l’esprit, c’est que je ne reverrai pas la si belle mademoiselle Champoux qui, conformément au règlement de l’époque, devait quitter l’enseignement pour se marier. Elle nous l’avait annoncé fièrement, ajoutant qu’elle allait partir en croisière sur le SS Homeric, un des bateaux qu’on pouvait observer de chez nous, au bord du fleuve, dans l’est de la ville.
On m’amène au huitième étage et on me place dans une chambre de huit lits, devant une télévision. Chic ! On n’en a pas chez nous. Un seul poste tourne en boucle : Radio-Canada.
Je suis traité par les docteurs Thibodeau et Thivierge. Le premier est grand et corpulent, le second petit, au crâne dégarni. Ils viennent tantôt seuls, tantôt ensemble. Je ne me souviens pas qu’ils ne m’aient jamais adressé directement la parole. Laurel (ou est-ce Hardy ?) demande une ponction. C’est un mot nouveau pour moi. À l’école, j’ai juste entendu parler de l’extrême-onction, et ce n’était pas une bonne nouvelle.
Le seul qui s’adresse vraiment aux enfants est Jimmy, l’infirmier (qu’on appellera désormais, au vingt et unième siècle, « préposé aux bénéficiaires »). Jimmy est un colosse. Ce jour-là, il vient chercher un enfant pour une ponction lombaire. L’enfant revient en pleurs, découragé de la vie. Pas trop encourageant pour ma ponction à moi. Le lendemain, Jimmy vient me chercher.
Tu vas voir, ça va bien aller.
Étendu sur la table d’examen, je vois le médecin sortir une seringue énorme, d’au moins huit pouces, munie d’une aiguille quasiment aussi longue. Jimmy est resté dans la salle, je comprends pourquoi : pour tenir le patient.
Je ressens une vive douleur quand l’aiguille entre sous ma rotule. Le cylindre s’emplit, lentement, d’un liquide verdâtre veiné de sang. Les deux genoux vidés, on me met un plâtre, des chevilles à la hanche. Puis, je reste couché pendant plusieurs semaines. Aucune mobilisation, même une fois le plâtre enlevé. J’aurai beau essayer, je ne pourrai plus m’asseoir en tailleur, ou « en indien », mes genoux ne pouvant plus fléchir complètement.
Mais rien ne change, les douleurs persistent. Hardy, ou est-ce Laurel, décrète la nécessité d’une biopsie du genou.
— Ça va bien aller !
À défaut de réussir à poser un diagnostic, on me déclare porteur d’une fièvre rhumatismale, qui peut mener à des problèmes cardiaques.
Ma mère me visite tous les jours. Elle m’a dit de dire que j’étais tombé dans la cour d’école pour expliquer mes ennuis de genoux. Je comprendrai plus tard qu’elle réclamait des sous de mon assurance scolaire pour payer les frais d’hospitalisation. Ceux-ci deviendront gratuits en 1961. J’ai appris que ma mère était rusée.
Début août, je suis transféré à la Clinique BCG, connue plus tard sous le nom d’Hôpital Marie-Enfant, un édifice de quelques étages, où se retrouvent des enfants au visage tout bleu, des enfants cardiaques, des enfants atteints de fibrose kystique et d’autres comme moi, j’en conclus, à l’espérance de vie abrégée. On me dit simplement :
— Tu vas être bien là, ça va bien aller.
Chambres monacales. Au menu, pour déjeuner : un œuf au jaune coulant, blanc morveux, frette, une toast dure et frette ; pour le dîner et le souper : hachis avec un je-ne-sais-quoi de vomitif, frette, six jours par semaine. Dimanche, ô le luxe, une cuisse de poulet maigrichonne avec des patates en poudre ; pour souper : un sandwich au fromage, pas toasté, proche parent du caoutchouc.
Il y a tout de même l’école. Madame Martin, qui disait être la petite fille de Médéric, autrefois maire de Montréal nous enseigne. Pour la première fois, je côtoie une célébrité ou, en tout cas, quelqu’un qui en connaissait une.
Quatre élèves, trois de cinquième année, et moi qui suis en quatrième. Un des enfants, n’appréciant pas que je réponde aux questions de madame Martin plus vite que les autres, me saute dessus, vole certaines de mes choses dans mon garde-robe.
Ça ne va pas bien, je crois.
Durant l’automne, une auxiliaire me demande si j’ai hâte de retourner à la maison. « Garde » Jutras, grande, mince, les lèvres imperceptibles tant elles sont pincées, murmure : « There’s no way in hell that he’ll be home for Christmas. » Je n’ai pas répondu, même si j’ai tout compris. Je prends l’engagement de sortir de là. Se taire, c’est une approche qui me servira plus tard, et dans plusieurs pays. Ne pas laisser voir qu’on a compris, attendre le bon moment pour riposter. En rétrospective, j’aurais dû suivre davantage cette ligne de conduite. J’ai aussi appris que, souvent, les adultes prennent les enfants pour des cons.
Je vais mieux. On me libère.
Je reviens à la maison le 19 décembre, la veille de mon neuvième anniversaire.
J’apprends alors que ma mère fréquente un monsieur qui a six enfants et une grande maison.
Je dors dans un petit lit dans le coin de la chambre de ma mère. La chambre est séparée du salon par un rideau.
Un soir, j’entends le monsieur dire à ma mère :
— Mon garçon m’a demandé si on allait se marier.
Ma mère répond sans hésiter :
— Paul m’a demandé la même chose.
Je n’ai jamais demandé ça !
J’apprends, ce soir-là, qu’une mère peut mentir.
On annonce le mariage. Au moins, mes frères et moi aurons à manger. De plus, le monsieur a la télévision.
Ça va bien aller.
Le jour où l’enfant capitula
Pourquoi, pourquoi
pourquoi moi ?
Amis au parc, dans la rue, dans la boue,
et moi encabané en pédiatrie,
tenant à peine debout.
Pourquoi, pourquoi
pourquoi moi ?
Parce que c’est comme ça,
me dit mon for intérieur,
ma p’tite voix :
Dis-le donc, que t’es en esti.
Contre ton christ, contre ta vie.
Nuits lacrymogènes, dépit devant l’injustice.
Nuits occupées à compter les tuiles au plafond,
à sentir l’émiettement articulaire,
os frottant sur os, attisant les douleurs,
qui font mal, et me donnent signe de vie,
la pulsatile, au rythme de mon cœur,
la lancinante, avec laquelle je respire,
la sourde, la lourde, l’envahissante,
même quand je souris.
Elles accompagnent la métamorphose
de mes mains en cols de cygne, en coups de vent et en boutonnières,
luxations luxuriantes.
Esculape poétise, imagerie médicale.
Ma colère éclate au petit matin.
Docteur, Docteur, pourquoi
je ne rentre pas chez moi ?
Je suis tanné, c’est pas juste !
Écoute-moi bien, mon pitt’.
Il m’a appelé son pitt’ bien vite.
Mon père décédé, son fils pas décidé,
il joue le rôle du papa
qui a toujours raison,
il suit ce que je fais à l’école,
si j’apprends bien mes leçons.
Écoute-moi bien mon garçon :
Je suis juste un médecin,
je ne fais pas de miracle !
Non mais, regarde-moi bien,
j’ai-tu l’air de Saint-Joseph ?
Tu veux t’en aller ?
Y a juste un moyen :
prends-toi en main.
Moi, je vais t’aider.
Sonné, un peu honteux même,
comme quand ton père te surprend à quelque délit.
Je ravale, bien décidé à contrôler ma vie.
Mais subsiste :
pourquoi, pourquoi,
pourquoi moi ?
Et pourquoi pas ? dit la voix.
C’est comme ça, habitue-toi.
Tu n’en as qu’une, une vie.
Alors, pas à pas,
remis debout,
j’ai repris goût aux alentours,
trouvant beauté çà et là,
chez les gens.
Un de ces jours-là, j’ai vu Denise, fière,
le voile bleu d’auxiliaire flottant derrière sa tête,
entrer dans ma chambre, me regarder,
me sourire et me dire
« je crois bien que tu fais de l’acné ».
Ses yeux m’ont botté hors de l’enfance.