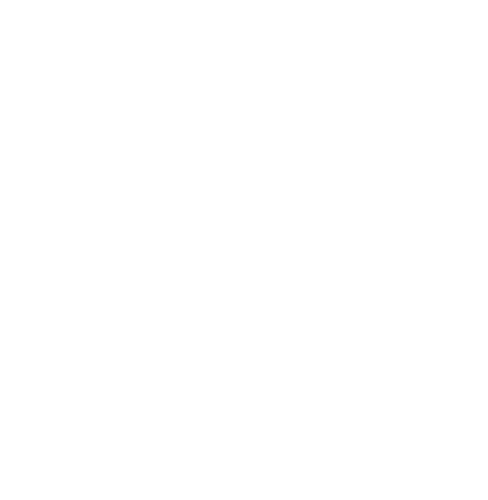Danielle Guénette
Greffée du foie
La nuit de l’encéphalopathie

J’ouvre les yeux.
C’est le milieu de la nuit, il me semble. J’ai froid, je pense que j’ai mouillé mon lit. Je refuse de le croire, mon cœur s’emballe, la honte m’assaille. Je me mets en petite boule dans un coin encore sec de ma double couchette, où je dors seule. Je me sens bizarre, envahie par des sensations inconnues, apeurantes qui déferlent en moi avec une vigueur inouïe. Est-ce un rêve ?
J’ a i pe u r.

J’ouvre les yeux.
Pourquoi n’ai-je plus de couvertures pour me tenir au chaud? Je tremble, je n’ai plus qu’un drap pour me couvrir. Ah oui ! Ça me revient. Je me suis laissé aller, j’ai fait pipi dans mon lit, comme une enfant. J’ai froid. Manquons-nous d’électricité ? Voyons, qu’est-ce qui se passe ? La peur me glace les veines.
J e gli s se d ans le s omm eil…

J’ouvre les yeux.
Tel un ruban sans fin, le drap s’entortille autour de mon corps transi. Je grelotte de froid et la panique me guette tandis que mes dents claquent. Je voudrais tellement comprendre ce qui m’arrive. Le chauffage semble déficient, y a-t-il une panne de courant ? Suis-je en danger ? Devrais-je fuir ? L’incompréhension et ces questions sans réponse me perturbent. Je m’agite. Je ne sais plus où me mettre, me semble que c’est humide… pourtant je reste figée là.
Je n’a im e p as ç a.
T o ut di spa raî t.

J’ouvre les yeux.
Mon réveil sonne, pourtant je ne l’avais pas programmé, puisque je n’ai pas à me lever. Ça m’agace, me tourmente, m’exaspère. Qu’est-ce qui se passe ? Je vais réveiller les voisins, si ça continue. Impossible de l’atteindre pour l’arrêter, l’effort est trop grand. Je m’impatiente : mais pourquoi ce vacarme assourdissant ? J’attaque de mes bras et de mes jambes ces sons stridents comme pour les chasser, je me débats sur mon grabat.
je p erds l’es pri t…?…

J’ouvre les yeux.
Toujours ce cadran qui me perce les tympans. Je ne peux pas bouger. Je voudrais me réchauffer. Je sanglote. Je divague avec l’impression de perdre tout repère, je ne comprends plus rien autour de moi.
C’e st l’e f f ro i, je m ’enl is e…

J’ouvre les yeux.
Le silence règne, enfin le réveil s’est tu ! Je me lève, je vais à la toilette. C’est bizarre, il y a des raisins secs sur le plancher, à la descente de mon lit. Je ne me rappelle pas en avoir mangé ! Je peine à les éviter en me levant, j’en écrase même quelques-uns. Les voisins doivent me détester d’avoir fait tant de bruit. J’irai m’excuser. J’erre dans la maison, tout est nébuleux. Je retourne dans ma chambre et me recouche.
Rec r oqu evi llée, je m’a pa ise un p eu, pu i s m’end ors.

J’ouvre les yeux.
Mon lit est tout défait. Je me lève pour aller m’étendre sur le divan dans le salon avec ma doudou. J’ai une croûte foncée collée à la plante des pieds et aux talons, mais ça ne m’empêche pas d’enfiler mes pantoufles en mouton ! Je vois, tout le long du corridor, ces petits raisins que j’avais aperçus dans ma chambre. Je trouve ça curieux, je ne me rappelle pas être passée par là, encore moins avec des raisins dans les mains, mais je n’ai pas l’énergie de me pencher pour les ramasser. Je me sens confuse, épuisée, étourdie.
Je fer me les ye ux.

Je me réveille avec la tête et le corps d’un lendemain de veille : je me sens faible, titubante et tremblotante. Mon esprit tente de peine et de misère de dissiper la confusion qui l’embrume. Mais qu’est-il donc arrivé ? Heureusement, les choses reprennent leur place petit à petit. J’appelle mon fils, j’ai tellement besoin de sa présence rassurante et je rejoins une amie, celle qui garde mon chien.
Je reste éveillée.

Je m’entête à vouloir m’excuser. Mes coups de fil m’ont ragaillardie, alors je prends mon courage à deux mains et, cahin-caha, je me présente chez mes voisins d’en haut, ceux que je croyais avoir dérangés. Là, on m’apprend que l’électricité n’a jamais été coupée, que mon réveil ne les a pas importunés ni aucun autre bruit d’ailleurs — ils ne savent même pas de quoi je parle et me regardent bizarrement. Je n’insiste pas, je repars encore plus embarrassée et toujours aussi confuse… finalement, le chaos n’aurait existé que dans ma tête ?

Dès l’arrivée de mes sauveurs, je leur raconte, par fragments et avec beaucoup d’émotions — car j’ai eu très peur et, de ça, je me souviens très bien —les pertes de conscience et les bouts d’éveil vécus durant la nuit. Je leur parle des raisins que je ne me rappelle pas avoir mangés, mais seulement piétinés ! Mon amie inspecte l’appartement. Elle revient peu de temps après et, au bord du fou rire, me dit : « Danielle, tes raisins là, ben, c’est pas des raisins, en fait ce sont de petites boules… d’excréments… humains. »
Voyant ma réaction, ils se retiennent tous les deux pour ne pas éclater de rire !

Mais pour moi, c’est l’horreur ! Y’a personne d’autre que moi ici, faut bien que ça vienne de moi. Un grand vertige s’installe à la pensée que j’ai pu faire ça sans en conserver le moindre souvenir. Qu’ai-je bien pu faire d’autre ? Je suis estomaquée. Je pleure. Je ne sais pas quoi dire à mon amie, à mon fils. Je suis honteuse. Je pense soudainement à mes pieds : pas des raisins, de la merde que j’ai sous les pieds ! Ces pieds que j’ai glissés dans mes pantoufles de mouton que je cherche d’ailleurs. Je les aperçois, souillées : j’ai juste envie de vomir. Et là, maintenant, j’ai les pieds enroulés dans une doudou, sur le divan. Et dire que je suis allée dans mon lit tantôt, puis que j’ai marché à travers la maison, et quoi encore ?

On a gratté mes pieds avant de les tremper dans une eau additionnée de javel puis de les récurer à la pierre ponce et de les adoucir avec un baume odorant. J’ai pris une douche et enfilé des vêtements propres. On a dû manger une bouchée aussi. Mon garçon a insisté pour que je me rende à l’hôpital ; encore une fois, il m’a accompagnée. Mon amie, elle, a tout lavé, tout désinfecté : elle a jeté les pantoufles sans autre forme de procès ; changé les draps et la housse du matelas, lavé la doudou, récuré les planchers. Et dire qu’on n’a trouvé aucune trace d’urine sur mes draps…
Ils ont su tous les deux être très réconfortants ; heureusement qu’ils étaient là !

À l’hôpital, on m’a expliqué le phénomène d’accumulation de toxines dans le cerveau, principalement de l’ammoniaque, dû au dysfonctionnement du foie, et qu’on appelle encéphalopathie hépatique. Ça m’a rassurée de savoir qu’il y avait une vraie cause médicale pour cette nuit d’enfer et que, non, je n’étais pas en train de basculer dans la folie ! Ce fut mon seul épisode. Peu de temps après, la greffe est venue mettre un terme à ces troublants dérèglements !

Texte et photos de
Danielle Guénette
24 février 2021
Réfectoire
Vivant seule en appartement, j’avais pris la décision, bien avant la greffe et grâce à ma famille, de commencer ma convalescence dans une résidence privée pour retraités. Les personnes de l’extérieur, même celles ayant moins de 65 ans, qui désiraient y séjourner temporairement à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’autres problèmes incapacitants de santé, pouvaient le faire. J’avais déjà fait ma réservation, il ne restait plus qu’à déterminer la date d’occupation, et à espérer un synchronisme parfait entre la greffe, mon congé de l’hôpital et la disponibilité de la maison de retraite. Difficile à prévoir, la date d’une greffe et, encore plus, celle du congé qui suivra ! Heureusement, tout concorda et je pus m’y rendre dès ma sortie de l’hôpital.
***
Je suis accueillie chaleureusement le soir de mon arrivée. On m’informe des heures des repas servis dans la petite salle à manger de l’étage particulier où je logerai, on me guide à travers les aires communes luxueuses de la résidence et on me dévoile le secret du code pour utiliser à ma guise l’ascenseur.
La chambre me convient parfaitement avec sa cuisinette, son mini frigo et sa salle de bain moderne et propre. Le lit s’annonce confortable, les meubles sont adéquats pour mes besoins transitoires. Et il y a la télé : je suis sauve !
Le premier matin, habituée au brouhaha qui sévissait tôt à l’hôpital, je suis prête à l’heure dite et j’ai bien hâte d’aller rejoindre les autres pensionnaires de l’étage à la salle commune pour le petit-déjeuner.
Une douzaine de tables sont alignées en trois rangées. Une cuisinette borde la première où une préposée s’affaire autour du grille-pain, de la cafetière, des pots de confitures et autres garnitures. Plusieurs places sont occupées, pourtant je n’entends rien, sinon ces voix, trop fortes, de celles qui s’adressent à des gens qui n’entendent plus ou qui ne veulent plus rien entendre.
« BUVEZ VOTRE CAFÉ, MADAME GAGNON. ATTENTION POUR PAS VOUS SALIR MADAME CÔTÉ. AVEZ-VOUS FINI MADAME LAVIGNE ? DÉPÊCHEZ-VOUS LÀ ! »
Chacun – on pourrait dire presque sans se tromper chacune puisque, pour la grande majorité, ce sont des femmes – regarde son assiette, tête basse et épaules effacées, ou porte un regard vide là-bas, au loin, revivant peut-être de doux souvenirs de repas joyeux à la maison, avec les enfants, avec leur famille. Quelques regards furtifs croisent bien le mien, mais aucun n’est suivi d’un sourire, d’un sourcil relevé ou froncé ni même d’un signe de tête. Il règne dans cet endroit une atmosphère de résignation, il y flotte une odeur qui n’est pas celle du printemps et de ses lilas, mais qui, heureusement, est assez bien camouflée par celles du pain qui grille et du café qui a percolé. C’est à ce moment précis que je réalise que je suis entourée de personnes atteintes de démence. Je comprends maintenant la nécessité du code secret pour quitter l’étage.
Les préposées vont et viennent entre les tables. On me propose du café, on me demande ce que j’aimerais manger. Le hic c’est qu’on m’a retiré toutes les dents du haut et quelques-unes du bas aussi, deux jours avant la greffe. J’avais négligé mes soins dentaires et, la bouche étant une porte grande ouverte à l’infection, il devenait nécessaire de tout enlever si on voulait pratiquer cette inéluctable greffe. Manger représente donc un défi et l’image que j’ai de moi, édentée, affaiblie, endolorie, et quoi encore, laisse à désirer.
On m’apporte deux toasts avec du caramel et on réchauffe mon café. Je me concentre sur la mie sucrée et abandonne les croûtes à peine mâchonnées dans la petite assiette. Je me sens un peu découragée devant la perspective de prendre tous mes repas en cette compagnie. J’aurais plutôt besoin de sentir à nouveau l’effervescence de la vie, pas la turpitude de la mort à laquelle je viens d’échapper.
Ç’a été mon seul repas pris dans ce réfectoire un peu trop près des limbes, flanqué à la porte du ciel. Tous les autres, bien que mous et pas toujours très ragoûtants malgré leurs saveurs inaltérées, j’ai préféré les savourer, seule et pénarde, dans ma petite chambre. Je ne suis jamais retournée dans cette partie de la résidence.