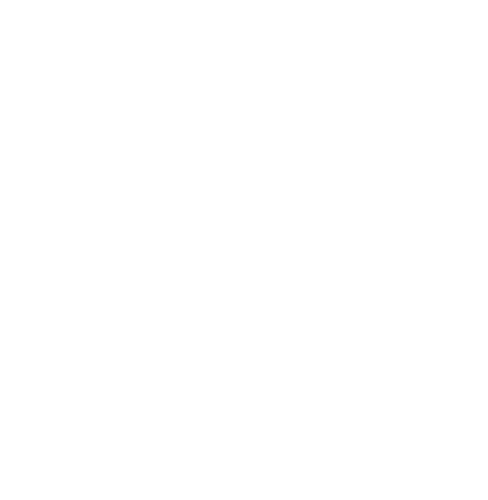Céline Beaulieu
Greffée du rein
Un cadeau inestimable et libérateur
Je remercie mon donneur et sa famille pour leur immense
générosité. Je remercie aussi la formidable équipe médicale de
l’Hôpital Notre-Dame de m’avoir donné le meilleur.
Assise à la véranda, nouvellement retraitée à l’aube de ma soixantaine, je prends le temps de contempler la nature sauvage au cœur de laquelle je me suis établie il y a quelques années. J’apprécie le résultat des efforts acharnés qui ont permis la construction de notre jolie maison au bord d’un petit lac.
Tout en me berçant doucement, je me remémore les quelques dernières années. Vers l’âge de quarante ans, je me suis donné une seconde chance d’avoir un amoureux. Depuis, lui et moi sommes devenus de grands compagnons à travers un chemin qui s’est révélé plutôt périlleux. Peu après le début de notre relation, il a reçu un diagnostic de cancer à traiter d’urgence pour espérer lui éviter le pire. Pas question que je mette fin à notre relation : je l’aimais déjà. Nous avons fait face ensemble à la chimiothérapie, à la radiothérapie, aux examens ultraspécialisés, au triple pontage coronarien, puis à la convalescence. Tout cela, nous l’avons entremêlé de rires, de distractions et de dérision. Nous n’avions pas de temps à perdre avec la maladie. Nous avions du bonheur à rattraper tous les deux.
Je me rappelle aussi, bien avant, faire la promesse à mon fils encore tout jeune de ne jamais le laisser tomber, d’être là lors de ses grands moments de vulnérabilité, alors que le psychologue confirme que ce petit garçon de trois ans a bel et bien une déficience intellectuelle. Une raison de plus pour moi d’être bien présente, vivante et disponible.
Puis est venu mon tour, comme si chacun, inévitablement, tirait une mauvaise carte à un moment de sa vie. Alors que j’étais à l’urgence de l’hôpital pour une forte douleur qui m’inquiétait, j’ai appris que j’avais une maladie polykystique qui commençait à se développer. « Vous devez vous tromper de dossier », ai-je osé dire au médecin. Mais non : un kyste s’était rupturé, il y en aurait de nombreux autres, ils allaient grossir et diminuer d’année en année la capacité de filtration de mes reins. Mon sang allait accumuler des résidus organiques qui devraient normalement être éliminés, comme un poison qui allait insidieusement ruiner ma santé. Il faudrait faire un suivi régulier.
Je tendais cependant à oublier tout cela, d’autant que les malaises n’étaient qu’occasionnels. Je m’adaptais à cette nouvelle situation. Il y avait bien à faire ailleurs. Mon conjoint et moi entreprenions de nous bâtir une maison sur un terrain enviable, et d’adopter un nouveau mode de vie, paisible, dans la nature, là où le ciel est clair et sans fin, sans obstacle urbain pour empêcher de reconnaître les étoiles dans la nuit. Des levers et des couchers de soleil, bien que cachés par une armée d’arbres matures, parvenaient à déployer leurs reflets colorés de rose, d’orangé et parfois de rouge sur un magnifique lac capable d’émerveiller quiconque se croirait insensible à cette beauté.
Près de huit années après le diagnostic initial, un examen sanguin a révélé un chiffre alarmant : 200, une référence pour les médecins spécialistes. À 200, on doit se préparer à une solution alternative, car les reins se dirigent vers leur inévitable destin. Prévoir une greffe de rein était souhaitable, mais il n’y avait pas de donneur possible dans mon entourage immédiat. Les autres hésitaient ou se laissaient dissuader. Mon réseau familial et mon cercle d’amis étaient un refuge, un grand réconfort. Mon travail, quoique demandant, me distrayait, il me permettait de croire en mon utilité, malgré ma santé fragile et ma vulnérabilité. Mais je suis vite devenue trop fatiguée. Mon corps s’est mis à afficher des signes de vieillissement prématuré. Le fameux chiffre est passé à près de 450. Anémique, j’ai dû cesser de travailler. Je sentais que ma vie pouvait basculer, mais je devais suivre le courant. Je m’accrochais, j’attendais. Je sentais que j’avançais sur un étroit chemin, le long d’une falaise : d’un côté, le vide, de l’autre, le mur de roc.
Mon amoureux et moi avons alors officialisé notre lien. Le mariage a eu lieu en toute intimité. Nous souhaitions que ce soit un pur moment de bonheur. Il nous a donné un nouveau souffle. Peu de temps après, le chiffre est monté à 500. Mes reins filtraient à moins de 10 %. Il s’est agi d’une époque charnière. J’ai dû commencer la dialyse. Les règles se sont assouplies, c’est un soulagement. Je reprends alors le travail. L’hémodialyse à l’hôpital nécessite des traitements trois soirs par semaine après le travail. Les journées sont longues. Je suis devenue une patiente et il y a de nombreux inconvénients à cet état : être vue comme une personne malade à protéger et même, parfois, à mettre à l’écart. J’expérimente l’attente : à chacun son tour, s’installer à son poste, pas toujours confortable, vivre la douleur des aiguilles, et la fistule au bras gauche qui s’est hypertrophiée, sur le point d’éclater, il m’arrive de ressentir chaque pulsation à travers les os de mon bras. Il y a les chutes de tension artérielle, les humeurs variables du personnel soignant ou des autres patients… Il y a encore la diète, la fatigue, le besoin récurrent de dormir. J’ai envie d’avoir plus de temps avec ma famille, plus d’énergie au travail, et plus d’enthousiasme dans mes activités. Je crains que la greffe n’arrive jamais et je m’efforce de ne pas y penser jour après jour pour ne pas être déçue d’un jour à l’autre. Je souhaite une vie enfin normale, une vie à moi.
En même temps, on vérifie l’état de ma santé, je passe des examens de laboratoire, de sang, d’urine, des radiographies, des échographies, des scans, et bien d’autres… Tous les systèmes de mon corps sont vérifiés. Il ne faut pas de défaillances en vue d’une greffe. Il faut plutôt de la résilience, un certain lâcher-prise, faire confiance aux médecins spécialistes qui en savent plus et qui ne cessent de se perfectionner.
Une vie routinière reprenait son cours : travail, tâches domestiques et familiales, et certaines activités légères pour garder la forme. Les chiffres s’élevaient parfois à plus de 700, puis redescendaient avec une séance de dialyse. Il m’arrivait des moments de découragement : je pleurais, voulais baisser les bras, ne plus espérer. Chaque fois pourtant, je retrouvais vite ma bonne humeur habituelle, je retrouvais l’espoir. Mon mari m’était d’une grande consolation : il me soutenait, me changeait les idées, me faisait rire. De lui qui a été sauvé in extrémis, je me suis souvent inspirée.
Après dix-huit mois, on a organisé l’hémodialyse à domicile. La machine a été installée dans le coin de la petite chambre d’amis : elle allait épurer mon sang une nuit sur deux. Mon mari et moi étions seuls pour interagir avec ce robot, muni d’alarmes et de mises en garde, prêt à crier au moindre de mes mouvements pouvant déranger quelque paramètre.
Un an, deux ans, deux ans et demi se sont écoulés. Par un matin d’été, alors que je m’affairais à ranger du matériel de dialyse, entourée de nombreuses boîtes au sous-sol, j’ai entendu le téléphone sonner. J’ai hésité d’abord à monter en vitesse les escaliers, par crainte d’être essoufflée. Finalement, j’ai couru répondre. Le médecin prenait de mes nouvelles et il m’informait qu’il avait un rein pour moi… Mon cœur s’est mis à battre très fort, j’en avais le souffle coupé. J’étais incrédule, une série de questions a traversé mes pensées : ma vie allait-elle basculer ? Y avait-il un rein pour moi, pour moi et non quelqu’un d’autre ? Je m’étonnais soudain d’éprouver un sentiment de colère que je n’avais jamais osé laisser s’échapper. Était-il possible que je vienne à bout de cette maudite maladie ? Pouvais-je espérer enfin sortir, voyager ? Était-il possible d’être délivrée, libérée de cette vie devenue presque une prison ?
Alors une grande joie, une excitation incontrôlable m’ont envahie. À l’hôpital, il m’était difficile de contenir toute ma nervosité. Il n’y avait plus de place pour la patience. « On doit attendre que le rein soit prêt. » J’ai tenté de me calmer. Moins de vingt-quatre heures après l’appel, j’étais greffée… Et tout allait bien. J’allais me rétablir lentement. Les chiffres allaient baisser peu à peu, sans recours à la dialyse : 400, 300, 200… Neuf jours plus tard, je sortais de l’hôpital, où je retournerais toutefois pour un suivi strict et fréquent.
Chez moi, j’ai continué longtemps de vivre cette euphorie, comme s’il me restait des effets secondaires de la morphine. Ma condition s’améliorait constamment. Je marchais sur la longue galerie pour reprendre mes forces. Le greffon en souffrance prenait le temps nécessaire pour s’établir. Tout mon corps et toute mon âme l’ont apprivoisé, dorloté, aimé. Il y avait trop longtemps que je n’avais pas été aussi bien.
Chaque jour qui commence est une grâce et une liberté, une vie pleine de promesses. Il me semble dorénavant que plus aucune contrainte ne s’imposera : j’ai reçu un cadeau inestimable.
Aujourd’hui, il fait beau, j’observe des écureuils qui se bousculent pour une noix, les oiseaux paradent de branche en branche et chantent. Un lot de petites fleurs délicates et éphémères annonce la fin de l’été, un arbre cassé s’est refait des branches pour se rééquilibrer, la brise berce les feuilles et glisse sur de petites vagues du lac, les saisons défilent les unes après les autres, incontestablement. Mon environnement m’a appris le désir de vivre et de survivre, la patience, le respect d’un rythme donné : chaque chose en son temps. Les imperfections cherchent à se corriger, naturellement ou avec un peu d’aide, un coup de pouce humain dans toute sa bonté et sa science. Les moments grandioses aussi bien que les moments tout simples sont une source d’émerveillement et de bonheur. Je savoure ma liberté, faite de petits et de grands projets, de voyages. Je prends soin de ma famille, de mon fils revenu à la maison, qui a hérité d’une polykystose rénale, lui aussi. J’apprécie ma vie dans le calme et parfois le tumulte de ma nature.